La coexistence, dans les pays majoritairement musulmans, entre les juifs, les chrétiens et les musulmans est vieille de plusieurs siècles. Les différentes communautés ont survécu et le pluralisme a parfois été réel et positif dans l’Empire ottoman, en Égypte, au Liban, au Maroc, en Algérie, en Irak, en Iran, etc. Il existe pourtant des problèmes, des foyers de tension importants, qui mettent en péril la sérénité de la vie inter-communautaire. Il est urgent de le reconnaître et de chercher des solutions. Pour ce faire, il ne suffira pas de rappeler les grands principes de l’islam que nous avons préalablement mentionnés tout en nous persuadant de leur immédiate applicabilité. Ce serait simplifier dangereusement les choses et éluder dans le même temps la question la plus importante qui soit : comment mettre en mouvement les réformes qui permettront, aujourd’hui, en tenant compte de l’état des différents pays, de s’approcher d’un modèle de coexistence basée sur le pluralisme dans le respect des différences religieuses, linguistiques et, plus largement, identitaires ? Les sources islamiques exigent de chaque société, à chaque époque, qu’elle trouve les moyens de cette actualisation. Il en va de notre responsabilité et nous devons engager ce débat sur le plan interne sans omettre de tenir compte de toutes les études juridiques effectuées sur ces questions au niveau international (ONU, CSCE, Conseil de l’Europe).[1]
Deux remarques importantes sont à faire ici en ce qu’elles ont des conséquences sur le débat qui nous occupe. En premier lieu, il convient de noter que les législations « importées » durant la période coloniale dans les pays musulmans et « plaquées » (ou appliquées avec un degré d’adaptabilité très relatif) sur une réalité sociale pourtant très différente n’ont pas résolu, et de loin, la question de la coexistence entre les communautés. Les tensions sont vives et, sous le vernis d’une législation « unitaire » qui confond l’État et la nation, la citoyenneté et la nationalité, s’expriment des appartenances particulières, des réseaux identitaires qui impriment leurs marques à la vie sociale. L’assurance qu’ont les pouvoirs d’appliquer le meilleur des modèles –puisqu’il provient de l’Occident « si avancé »[2] – pourrait ne pas survivre à l’analyse rigoureuse des situations : un modèle constitutionnel assurant la justice en un lieu donné peut produire, exporté tel quel, des injustices notables compte tenu du décalage qui existe entre la philosophie qui l’a pensé et la réalité sur laquelle il est sensé s’appliquer. On en a de multiples exemples dans les pays en voie de développement, à majorité musulmane ou non (et en Europe de l’Est comme nous allons le voir).
Il faut rappeler, en second lieu, que ni les États-Unis, ni l’Europe n’ont apporté de réponse aujourd’hui satisfaisante à la question du pluralisme des collectivités fondé sur la religion, la langue ou l’ethnie. Le processus de démantèlement des grands empires en Europe orientale, dans lesquels de nombreuses « nationalités » coexistaient, a donné naissance à des États dont la territorialité ne correspondait pas aux différentes appartenances identitaires. Dès 1878, à la Conférence de Berlin, la question de la protection des minorités est abordée : elle fait problème, et ne cessera plus d’en faire. Le « Traité des minorités » de 1919, pensé après les guerres balkaniques de 1912-1913 qui modifient les structures « nationales », laisse apparaître une différence entre le citoyen polonais et son identité ; on y lit : « Les ressortissants polonais appartenant à des minorités de race, de religion, ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties, en droit et en fait, que les autres ressortissants polonais. »[3] Étrange formulation. Les puissances alliées de l’Ouest avaient exporté leur modèle d’État-nation et, compte tenu de la particularité des populations en Europe de l’Est, se trouvaient dans une impasse : comment créer des États à la structure unitaire en cherchant à faire vivre des collectivités qui toutes exigeaient le légitime respect de leurs spécificités. Le principe de l’État-nation avait du mal à appréhender cette autre réalité. La fin du XIXe avait vu naître les nouvelles minorités, mais le Traité fait apparaître une expression juridique originale – « la minorité nationale » – qui fera couler beaucoup d’encre et sera au centre de débats dont nous ne sommes pas sortis aujourd’hui.[4]
Des discussions sans fin ont été menées autour de la question des minorités : lors de l’élaboration de la Déclaration des droits de l’homme, au niveau des États, dans les commissions, etc. Fallait-il, oui ou non, mentionner dans un article spécifique, la question de la protection des minorités ? Nombre d’États européens, et les États-Unis, s’y opposèrent : à leurs yeux, les droits de l’homme contenaient, englobaient, le droit des minorités. Ce que l’on avait accepté de reconnaître en Europe de l’Est, on refusait de se laisser contraindre à le considérer chez soi : les grandes puissances avaient participé à l’élaboration d’instruments juridiques internationaux qui n’imposaient pas que l’on fouille leur législation nationale. Ce fut d’autant plus vrai lors de l’élaboration de la Convention européenne des droits de l’homme (1950) et des Pactes additionnels (1966) à la Déclaration.[5]
Pendant des années de colloques, de renvois, de commissions créées puis désavouées, depuis près de huit décennies – au moins – on n’a pu se mettre d’accord sur une définition officielle de ce que recouvre la notion de « minorité ». On sait pourtant bien de quoi il retourne, mais les États s’opposent à toute formulation qui révélerait des défauts sur le plan interne et pourrait imposer des réformes constitutionnelles. L’État-nation, plus clairement l’État nationaliste, a quelque peine à donner une forme juridique au pluralisme : on s’est contenté le plus souvent de faire appel aux droits de l’homme et à l’idéal démocratique pour assurer le respect des identités. Sans subir de contrainte. Pourtant, le problème est loin d’avoir été résolu : effacer dans l’idéal, et légalement, les spécificités identitaires ne veut pas dire qu’elles n’existent plus. Presque tous les pays en Occident font face à des élans de réaffirmation des particularismes et l’on a bien du mal a résoudre ces questions : sauf à traiter leurs partisans de réactionnaires, allant à l’encontre de la marche de l’Histoire qui construit « la grande Europe » contre les « petites identités ». Le dédain se dispute à la moquerie et au rejet quand on en vient à considérer les revendications qui ont cours en Europe orientale : « De telles choses, en Afrique peut-être… mais en Europe… c’est impensable ! »[6] Et pourtant. Fabienne Rousso-Lenoir circonscrit le problème :
Appréhendé dans la seule optique de l’État-nation par le droit des droits de l’homme, l’homme minoritaire acquiert les mêmes droits que les “autres”, mais y perd cette partie de lui-même qui en est différente et qui ne peut s’exprimer que dans et par le groupe auquel il appartient.[7]
Il existe donc des lacunes que l’on ne peut pas ne pas considérer et ce surtout si l’on pense exporter le modèle démocratique dans les pays d’Europe de l’Est :
Les hommes politiques des vieux États-nations démocratiques de l’Occident, où Nation et État se sont développés de concert, ont encore des difficultés à percevoir combien le nationalisme centralisateur et, dans le meilleur des cas, intégrationniste, peut saper toute tentative d’établir à l’Est des démocraties réelles et effectives en enfermant l’État-nation et les minorités nationales dans un infernal jeu de miroirs.
Il est impératif de prendre la mesure des réalités spécifiques pour penser des structures qui permettent à chacun de jouir de ses droits fondamentaux. Le seul modèle de l’Europe de l’Ouest ne peut être appliqué à tout le continent sous peine de provoquer des tensions et des guerres dont le triste spectacle nous est offert tous les jours. La question des minorités demande donc un esprit inventif. Rousso-Lenoir mentionne les recherches de deux autrichiens, Karl Renner et Otto Bauer, qui ont élaboré un « système politique et juridique où État, nation et même territoire ne correspondent plus obligatoirement. » Selon eux, « le choix d’une nationalité est comme celui d’une religion, une affaire privée (…). La qualité de national ne provient plus de l’appartenance à un État mais à une nation (…). L’État, formé des nations qui le composent, conserve la sphère d’intérêt général et le national entretient avec lui des relations de citoyen. Le système proportionnel assure la représentation des nations au Parlement de l’État. »[8] Un projet politique qui désirerait promouvoir une réelle participation du peuple dans le respect des diversités et des identités doit proposer une structure souple qui respecte les valeurs et protège les droits. C’est le sens de la conclusion :
Unité politique et unité nationale ne se superposent pas obligatoirement, de même que vie nationale et système politique, nationalité et citoyenneté ou loyauté civique et attachement ethnique ou culturel. (p. 91)
Force est de constater que les difficultés perçues en Europe de l’Est trouvent un écho dans le monde musulman. Le modèle de l’État-nation exporté n’a pu convenir : issu d’une gestation de plusieurs siècles qui s’est confondue avec le processus de sécularisation, ce modèle est lié aux circonstances de son élaboration et conditionné par un certain nombre d’éléments dont le moindre n’est pas la formation de l’individu-citoyen. Toutes les tentatives qui, après les indépendances, ont fondé leur légitimité sur la « modernité » et la « portée progressiste » de leur gestion ont montré leurs limites : de Nasser à Bourguiba, de Ben Bella à Assad. L’échec est total et le principe de citoyenneté est partout absent. On s’aperçoit par ailleurs que le référent religieux est incontournable aujourd’hui : rois et présidents des États les plus « laïques » tirent leur légitimité populaire d’un constant rappel de leur fidélité à l’islam.[9] Les histoires ne furent pas les mêmes et la sécularisation opérée en Occident ne s’est pas réalisée dans le monde musulman, d’abord et essentiellement, parce que les rapports entre le religieux, le politique et le culturel ne furent pas les mêmes. On aurait tort de ne pas tirer enseignement de cet état de fait comme il convient, par ailleurs, de prendre l’exacte mesure des liens traditionnels qui traversent les populations au niveau familial, tribal et ethnique. Penser une structure politique qui permette le pluralisme suppose que nous tenions compte de ces spécificités et d’abord, comme nous l’avons dit, de la référence religieuse omniprésente. La structure politique devra sans aucun doute être originale, nouvelle, en prise avec le terrain auquel elle doit s’appliquer mais il est certain que l’islam, à la lecture des fondements que nous avons rappelés, préserve, en tant que référence, un large éventail de possibles dans les réalisations politiques.[10] Contrairement à l’Occident qui s’est libéré – plus ou moins relativement – du religieux pour créer un individu-citoyen, notre époque nous rappelle que c’est à l’intérieur de l’islam qu’une dynamique doit se développer qui permette une citoyenneté respectueuse des valeurs de chacun. On ne saurait persister à croire, sauf à s’aveugler indéfiniment, que l’on parviendra à un résultat en niant le substrat identitaire religieux et culturel. Des difficultés persistent à l’évidence : comment, dans les pays musulmans, gérer le pluralisme religieux en cette fin de vingtième siècle ? Introduire le concept si trouble de « minorité » ? Distinguer la citoyenneté de la nationalité ? Quel pourrait-être ce modèle attaché aux principes et en phase avec les réalités sociales contemporaines ?
Les musulmans aujourd’hui, s’ils considèrent les principes de coexistence extraits des deux sources de références, se trouvent devant un problème identique à celui auquel se sont heurtées les nouvelles démocraties de l’Est, avec, il va de soi, les spécificités religieuses et culturelles qui sont les leurs. Ils se doivent de penser une structure nouvelle qui offre à tous la citoyenneté en même temps que le respect de leur croyance. Sur le plan purement juridique, les penseurs musulmans n’ont jamais formulé la question de la coexistence dans les termes du couple « majorité-minorité ». Cela sans doute parce que d’emblée on avait compris, avec l’exemple de la Constitution de Médine, qu’il existait deux niveaux distincts d’appartenance[11] : celui de l’État qui fait de chacun un citoyen à part entière où il n’existe pas de majorité autre que celle qui naît des votes ; celui de la communauté religieuse pour laquelle il existe une autonomie de culte, de langue et de législation (pour les affaires privées).
Sans s’arrêter sur la terminologie, on peut voir que les réflexions produites par Renner et Bauer vont très exactement dans le sens des préoccupations islamiques contemporaines. Donner corps à une société qui concrétise les fondements islamiques de respect, d’autonomie et de participation des diverses communautés n’est point une affaire aisée. Les investigations doivent être nombreuses et l’on doit fixer les étapes qui permettront de passer des régimes, pour la plupart dictatoriaux, que nous connaissons, à des structures de participation à la base offrant aux non-musulmans un espace d’autonomie interne, en même temps qu’un véritable rôle politique.
La coexistence entre musulmans et ahl dhimma, si l’on ne veut pas se cantonner à l’élaboration théorique, n’est pas aisée et nécessite une réflexion approfondie, éloignée de toute simplification. La justice sociale que nous impose l’islam est à ce prix. On peut ne pas vouloir imiter le modèle occidental de l’État-nation et se donner la possibilité de constituer autre chose. Des chercheurs occidentaux, nous l’avons vu, l’ont fait et beaucoup d’autres s’y attellent aujourd’hui encore, persuadés que ce modèle a fait long feu. On peut et l’on doit s’engager dans cette voie ; mais il ne peut s’agir de produire des caricatures simplistes, ni non plus de répondre à l’humiliation subie sous la terreur par une autre humiliation que l’on imposerait à ceux, non-musulmans, qui « auraient fait le mauvais choix ». Ce type de réaction existe chez les musulmans, et tout un chacun peut entendre ces réflexions qui mêlent la beauté de l’espoir à la terrible simplification de la réalité, quand elle ne porte pas les germes d’une intransigeance dangereuse. Rien dans le message de l’islam ne nous permet de tels raccourcis. Bien au contraire. Affirmer que les principes révélés conviennent – en tant que principes et non en tant que solutions concrètes – pour tous les temps et pour tous les lieux, exige que nous cherchions à comprendre notre époque avec ses complexités et à répondre du mieux que nous pouvons aux exigences d’équité que porte la foi musulmane. Étape après étape, avec humilité et conscients de l’ampleur de ce fardeau. Les sources doivent réveiller nos intelligences et non pas seulement illuminer nos espoirs… car alors elles peuvent produire pire que ce qu’elles disaient vouloir réformer.
Il est impératif de faire l’état des lieux de chaque société et de prendre la mesure des tensions régionales et quotidiennes. Il faudra donner forme à un espace de pluralisme qui, dans le respect des fondements islamiques, tienne compte des situations contemporaines, des stratifications sociales, des enjeux… et du temps nécessaire à réaliser des réformes en profondeur. Somme toute, c’est bien une véritable culture politique qu’il faut dispenser aux populations qui depuis trop longtemps n’ont pu exprimer l’ombre d’un choix. La mise en place d’un processus de représentativité large, du principe de la délibération (shûra), qui doit donner ses droits à chaque citoyen, musulmans et non-musulmans, doit être élaborée en même temps que s’effectuent les recherches sur le plan législatif (projet de Constitution, lois spécifiques, etc). Cette double mobilisation est perceptible aujourd’hui dans le monde musulman. Depuis le Nord, on a l’impression que tout se joue entre les pouvoirs en place et leur opposition la plus radicale : qu’hors ce conflit perceptible, « rien ne se passe » qui ait quelque poids politique. L’erreur d’analyse est sans commune mesure : dans l’ensemble du monde islamique, des mouvements de base existent qui, par l’alphabétisation et le travail social, développent les germes d’une participation politique plus conséquente. C’est ce travail d’abord qui, à long terme, permettra de résoudre et de dépasser les tensions inter-communautaires. Prendre en compte ces dernières supposent un réel travail de terrain et un effort de collaboration continu. Sur le plan plus théorique, des théologiens, des chercheurs et des intellectuels musulmans n’ont eu de cesse, depuis des décennies, de produire livres et documents visant à faire avancer la réflexion : les références islamiques ont été expliquées, commentées ; des projets de Constitutions ont été élaborés, des colloques spécialisés organisés pour mieux sérier la problématique. L’activité intellectuelle et sociale est foisonnante même si elle n’est pas toujours ordonnée et constructive. Il existe aujourd’hui des instruments juridiques de référence qui doivent servir à l’élaboration d’une stratégie d’ouverture politique plus large. Elle seule peut permettre de concilier la citoyenneté participative et le pluralisme dans le monde musulman. Encore faudrait-il, du côté des pouvoirs en place, qu’il existe une réelle volonté politique de changement et, du côté des grandes puissances, autre chose que des discours d’intention. Il faut enfin rappeler avec force que si l’on peut parfois déplorer le traitement réservé aux juifs, aux chrétiens ou autres dans les pays musulmans, il convient de ne pas oublier que les musulmans eux-mêmes sont soumis aux pires humiliations dans leurs propres pays. Espérer une amélioration du sort des non-musulmans passe, naturellement, par l’exigence d’un respect et d’une dignité rendus aux musulmans également.
[1]. Rappelons que toutes recherches proposant des solutions qui, en soi, ne s’opposent pas aux principes islamiques, sont acceptables : c’est leur degré de moralité qui compte, non leur origine. Et ce notamment, surtout dirions-nous, en matière de législation générale.
[2]. Les grandes puissances ne tarissent pas d’éloges devant leur courage et leur volonté de vivre avec leur temps. Ils sont progressistes.
[3]. Cité dans l’ouvrage de Fabienne Rousso-Lenoir, Minorités et droits de l’homme, l’Europe et son double, Bruylant, 1994, p. 33.
[4]. Dans son ouvrage L’Europe et l’Orient, l’historien libanais Georges Corm a des propos très durs : « Le droit international public qui prend son essor durant cette période encourage d’ailleurs les aberrations. Il institue le terme de “minorité nationale” inconnu autrefois du vocabulaire politique européen. (…) Ce n’est qu’une fois l’État-nation institué dans la modernité comme forme supérieure de système de pouvoir que le terme de minorité nationale fera fortune. Le terme lui-même est pourtant absurde, puisqu’on ne peut être en même temps “national” et minoritaire ». Voir la suite du développement que Corm propose sur la question en relevant les contradictions de l’État-nation qui n’existaient pas dans les empires, et particulièrement l’Empire ottoman, puisqu’un réel espace pluraliste existait. Cf. éd. La découverte, pp. 92-93 et suivantes.
[5]. Concernant l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui commence par ces termes : « Dans les États où il existe des minorités… », la France prendra une position définitive : « Le gouvernement français déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que l’article 27 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République. » L’article est proprement balayé : la France ne reconnaît, en tant qu’État-Nation, aucune minorité nationale et ainsi le texte du Pacte ne peut la contraindre. Cf. Fabienne Rousso-Lenoir, op. cit. p. 105.
[6]. Dominique Wolton, dans son ouvrage La dernière utopie, comme d’ailleurs Fabienne Rousso-Lenoir, s’en prennent à ce paternalisme des « progressistes » qui font l’impasse sur une question majeure de cette fin de siècle.
[7]. Op. cit. p. 82.
[8]. Op. cit. p. 85.
[9]. On s’en persuadera en écoutant les discours de Saddam Hussein, de Yasser Arafat, de Hosni Moubarak, de Hafez al Assad, de Lamine Zéroual, de Ben Ali… tous, en permanence, parlent de l’islam et disent s’y référer.
[10]. Lire à ce sujet l’article de Hichâm ibn Abdallah el Alaoui dans Le Monde Diplomatique de juillet 1995, repris par Le Courrier de Genève (11 juillet 1995) : Être citoyen dans le monde arabe. L’auteur met en évidence les différences entre les modèles occidentaux et arabes et présente l’idée d’une alternative démocratique nourrie par les références islamiques.
[11]. À l’époque du Prophète, les communautés en présence à Médine étaient essentiellement les ahl al-kitâb, les gens du Livre, les juifs et les chrétiens. Abû Yusuf rapporte que lorsqu’il y eut un contact, plus tardif, avec les zoroastriens de Bahrein, le Prophète a dit : « Qu’il en soit avec eux comme il en est avec les ahl al kitâb. » Les premiers califes, et à leur suite les ulémas, ont compris que cette application par analogie pouvait s’étendre à d’autres peuples adhérant à d’autres croyances. Reste le problème des personnes liées à aucune tradition ou simplement athées. Les références islamiques ne se réfèrent pas à ce cas de figure compte tenu du contexte et de l’époque de la Révélation. La décision circonstanciée doit faire l’objet d’un ijtihâd. Des positions diverses ont été formulées : de la non reconnaissance absolue à la coexistence pensée en fonction de l’état actuel des sociétés. Cette dernière démarche relève le fait qu’il est deux principes inaliénables : le respect de la Constitution et la latitude offerte en matière d’affaires privées. Tout engagement personnel qui ne va pas à l’encontre de ce cadre peut être reconnu : on le voit, le raisonnement juridique élargit la sphère d’application en tenant compte des réalités contemporaines. Il demeure que la référence à Dieu, dans une société islamique, participe de son essence et fonde le cadre de référence qu’on peut ne pas partager mais que l’on se doit de respecter.




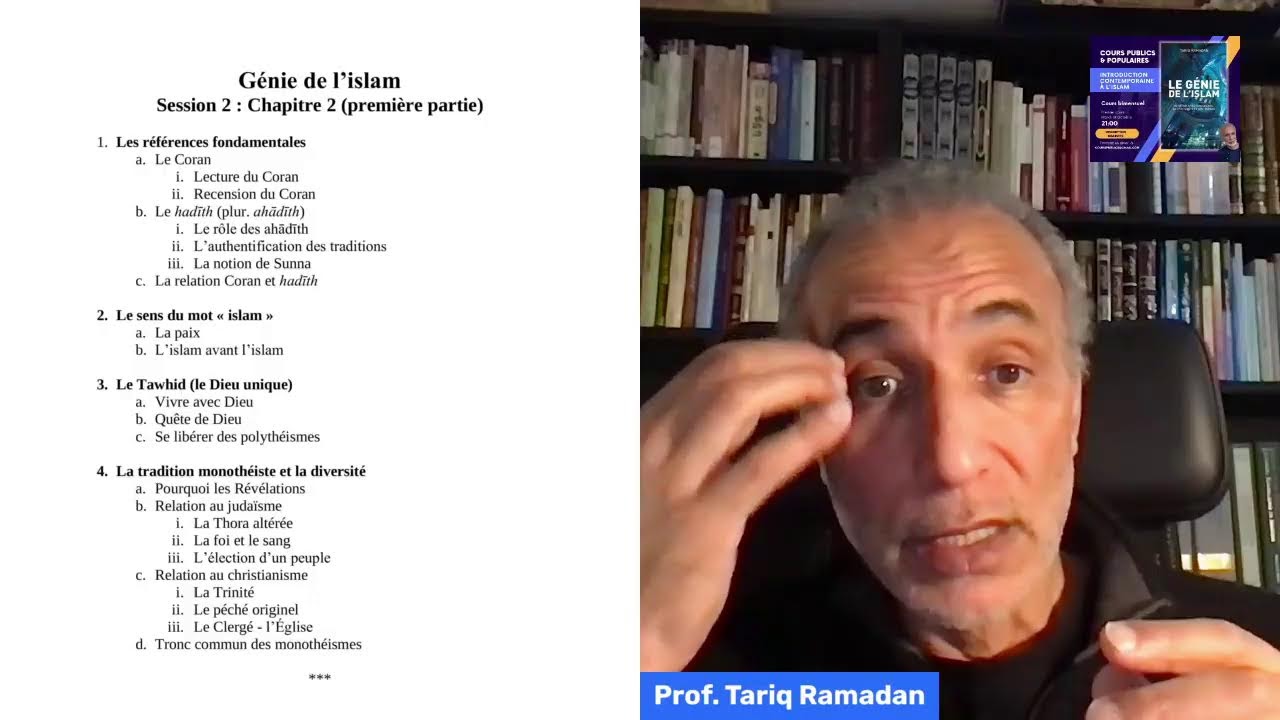





Bonjour. Merci pour cette synthèse très intéressante sur le sujet. Je voudrais vous interpeller sur un point : j’ai l’impression que quand vous parlez des non-musulmans, vous faîtes références aux juifs et aux chrétiens sauf à la toute fin du dernier article (c’est clairement le cas à mon sens dans la première partie dans laquelle vous évoquez les sources issues du Coran, de la Sunna et de l’Histoire).
Pourriez-vous écrire un article concernant les rapports entre société islamique et athées, agnostiques et croyants d’autres religions que les trois religions monothéistes ? Et dans le prolongement je serais également intéressé pour un article évoquant plus largement les relations entre les musulmans et les non musulmans (au sens large, c’est à dire croyants de toute religion et non croyants) mais dans des sociétés non islamiques, et notamment dans des sociétés sécularisées comme en Europe par exemple.
Merci !