Il n’y a pas d’humanité sans mémoire et en période de doute, de crise ou de conflit cette dernière est un refuge, un remède ou même un espoir. Elle l’est sur le plan personnel comme sur le plan collectif et ce phénomène est une constante dans les sociétés les plus traditionnelles comme les plus modernes. Rousseau avait eu cette intuition que viendra confirmer la psychanalyse : notre identité est le produit d’une mémoire habitée par des joies, des peines, des rencontres, des blessures et quelques séquelles de la vie. Le philosophe marginalisé vivait une crise et désirait comprendre, se comprendre et faire comprendre : il écrivit Les Confessions. Ce titre renvoyait à une pratique connue du christianisme et partagée – sous des formes différentes – par toutes les traditions spirituelles et religieuses : l’intelligence s’arrête, tourne son attention vers soi et son passé récent ou lointain et attend de la conscience qu’elle fasse un bilan, un bilan de mémoire. Pour comprendre, pour évoluer, pour grandir. Révéler les intentions et le sens du passé, la route qui a mené l’individu à son présent et les événements qui l’ont nourri et formé. La mémoire révèle, explique souvent et parfois explicite. La psychologie moderne, et la psychanalyse en particulier, ne conçoit la guérison que par l’acte de mémoire : revenir à ses parents, revivre ce que l’on n’a peut-être ni réalisé ni compris, identifier le refoulement, le traumatisme, le blocage. L’inconscient accumule, il est la mémoire passive particulièrement active et l’école jungienne a beaucoup insisté sur cet inconscient qui transcende l’individu. La modernité, par la réorganisation des rapports avec soi et le primat donné à l’individu, est d’abord intéressée par « la mémoire qui m’habite ». Les anciennes traditions avaient un rapport au temps et à l’amplitude communautaire et sociale fondamentalement différent : ce qui faisait sens était « la mémoire qui me porte ». Dans les deux cas, la mémoire est fondamentale et déterminante puisqu’elle permet de façonner l’identité des personnes, même si elle ne s’inscrit pas dans le même rapport à soi, au monde et au sens.
La globalisation a des effets paradoxaux, nous l’avons répété. La perte des repères et la grande mixité culturelle de nos sociétés entraînent des attitudes de «recroquevillement » individuel, social et communautaire autour de l’identité et de l’appartenance. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant. La référence à la mémoire est essentielle dans ce processus car elle se présente comme l’une des légitimités de la singularité et de l’identité. Il n’est pas d’identité sans mémoire. Grâce à elle, il est possible de se replonger dans l’Histoire, de donner un sens à sa présence, de justifier une appartenance et, en temps de crise ou de troubles, de se distinguer de l’autre. Ce qui compte, dans l’ère globale, est de pouvoir se prévaloir d’un héritage, d’une origine, de racines. Curieux renversement des choses : la modernité semblait nous avoir affranchis des traditions imposées, de leur autorité jamais négociée et de l’absence de reconnaissance de l’individu et de sa liberté critique. Or, voici que nos peurs, notre manque de confiance en nous et la peur de l’autre qui ébranle nos certitudes nous poussent à aller chercher dans nos mémoires la justification de nos différences et de nos appartenances. Les mémoires craintives recréent, ou plutôt réinventent, leurs traditions.
Mais ce ne sont plus tout à fait les mêmes. Les traditions d’hier avaient un souffle propre, une force et une énergie intrinsèques qui inscrivaient l’homme dans un ordre autant que dans un projet. Elles pouvaient limiter l’exercice de la raison, mais elles offraient un horizon : on peut critiquer sa légitimité scientifique et sociale – et c’est ce que les modernes ont fait –, mais on est obligé de reconnaître son utilité et sa capacité de créer de la cohésion culturelle et sociale. Les traditions nouvelles sont des œuvres de reconstruction : elles ont d’abord une fonction de démarcation avant d’avoir un rôle de cohésion intrinsèque. Hier, la tradition façonnait l’identité, aujourd’hui c’est l’identité qui reconstruit sa tradition. Il ne s’agit plus d’un souffle, mais d’un cadre, non plus de l’horizon d’un paysage mais des limites d’une frontière. Les civilisations, les cultures, les nations, les régions, les citoyens de souche, les immigrés, les anciens esclaves ou anciens colonisés, les indigènes, tous revendiquent des origines, une histoire et une mémoire qui justifient qu’ils spécifient leurs différences et s’opposent, le cas échéant, à l’instrumentalisation de l’Histoire par la mémoire de l’autre. La mémoire est un drapeau et une arme dans des conflits de représentation et de pouvoir qui sont destinés à assurer sa survie. Cette économie des mémoires est bien malsaine et elle se conjugue sur le mode exactement opposé à celui que désirait le rationalisme à la source de la modernité : il n’y a plus d’analyse critique ou d’intégration de la multiplicité des points de vue dans l’étude historique. On produit de la mémoire à partir de la fonction de ceux qui en ont besoin ou l’instrumentalisent : la mémoire est devenue une reconstruction fonctionnelle, un produit idéologique.
Aux sources de la modernité, il y avait cette volonté d’accéder à l’universel. Le projet de Descartes, au gré d’une méthode rigoureuse, était bien de parvenir à la vérité de tous et Kant espérait offrir à ses maximes ce même statut universel. La philosophie devait sortir de la culture et des religions pour formuler le rationnel commun de l’humain. L’émancipation a été phénoménale et les progrès industriels et scientifiques ont été révolutionnaires : l’économie est devenue planétaire, la communication instantanée et la culture mondiale. Au terme de son processus, au seuil d’une postmodernité dont on ne sait pas si elle existe ou non (tant les philosophes et les sociologues se disputent à ce sujet), la modernité voit son ordre renversé et elle est devenue la source non de l’universel commun mais de mémoires singulières et de particularismes revendiqués. Elle a commencé par la raison, elle semble être démantelée par les passions : nos mémoires sont émotives et ne s’identifient pas à l’« Histoire », et l’histoire commune n’est décidément pas la somme de nos mémoires.




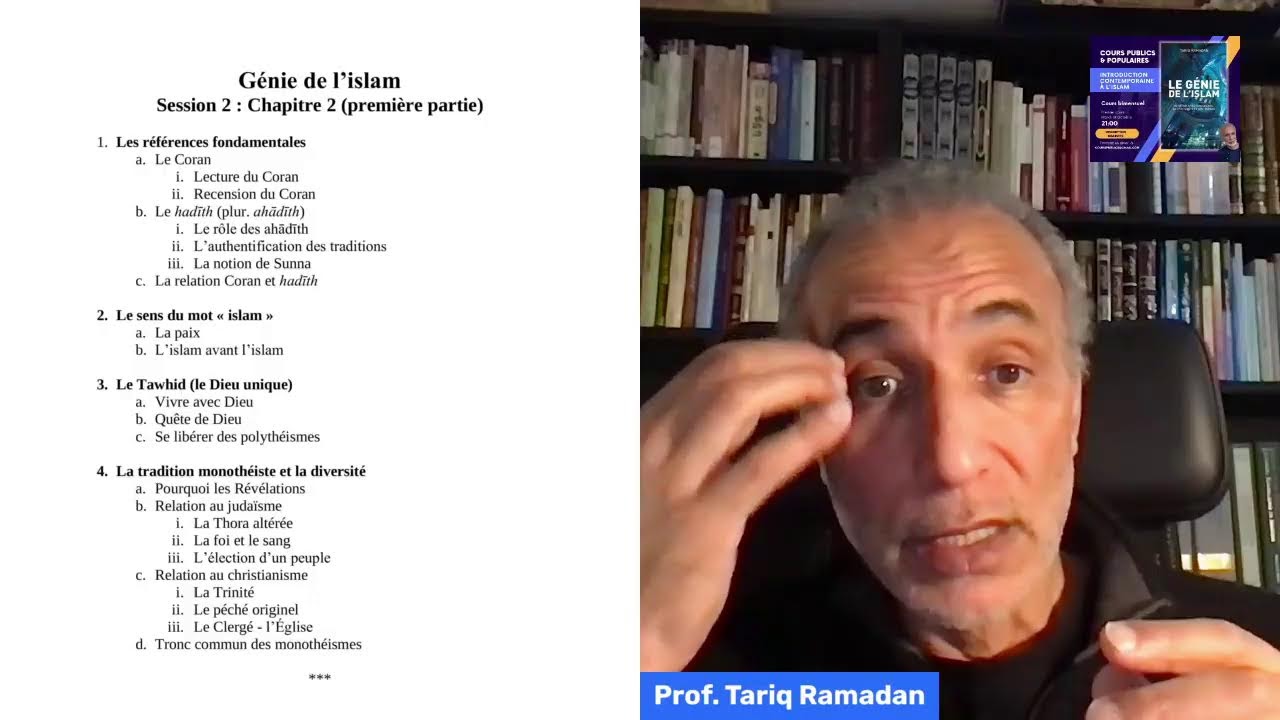





Salaam wa rahmatuhhah,
La mémoire collective a depuis toujours été la scène d’une reconstruction d’une cohésion, ou, -quand les choses tournent mal- d’un déconstruction de l’identité de l’Autre, c’est un mouvement de flux et de reflux, perpétuel. Il y a toujours eu, depuis la nuit des temps, un brassage culturel et identitaire au sein de communautés se côtoyant. En temps de crise, la mémoire collective ne résiste pas : on va chercher dans ce qui permet la (dé)construction de cette mémoire des justifications de toute sorte (par exemple les rois grecques se revendiquent des ancêtres divins pour unir un peuple vénérant ces divinités, et exclure tous les autres païens) ; En temps de crise, la mémoire collective ne survivra ni aux guerres, ni aux conversions ou intégrations forcées (elle se réduit, ou disparait à tout jamais). Par contre, en temps de paix, la mémoire collective s’enrichit de « nouvelles » mémoires collectives, quand les métissages sont tolérés et célébrés (elle s’épanouit).
Mais peut-être doit-on comprendre par les mots « traditions d’hier » et « traditions nouvelles » l’équivalent en arabe de « maarouf », càd ce qui est convenu dans une communauté ou un pays, càd, ce que l’on tient pour « bonne manière de penser », le « bien », le « correct » et qui peut changer à travers les époques (et les pays), en fonction des événements historiques, des réalités socio-économiques… etc.
En marge de ce sujet : comment les mémoires collectives des peuples vivant en EU, US, AUS, Myanmar… intègrent ou se réconcilient avec les décisions gouvernementales atroces de ces pays, telles que décrites ici : http://www.truthdig.com/report/item/migration_is_an_act_of_desperation_not_a_crime_20150514
Sommes-nous devenus majoritairement xénophobes à ce point ?
Dans le coran, il y a un célèbre verset qui dit : « La Terre de Dieu est vaste », et d’inciter les hommes à y trouver de quoi vivre, et demander à Dieu les biens qu’Il voudra leur accorder… Les hommes l’ont rendue toute moche, toute minuscule cette planète, ils ont renié le droit fondamental de tout homme d’y circuler, et d’y vivre.
Comment notre mémoire collective qui n’a aucun souci avec l’idée de patrie, de pays, de « mon chez moi », refuse-t-elle à d’autres personnes de couleur, de langue ou d’ethnie différente ce droit-là ? Nous sommes tous des immigrés, descendants d’immigrés, qui se sont installés en Europe, aux USA ou en Australie il y a quelques siècles, quelques décennies ou quelques années. Nous avons des mémoires collectives amnésiques et très hypocrites.